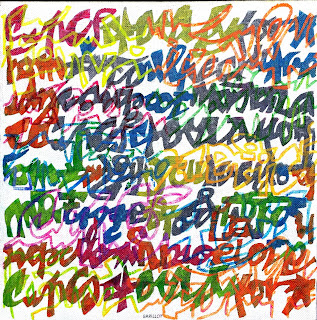Bernard Barillot
Le signe est un langage culturel commun à tous les peuples et c'est en ce sens qu'il me fascine, jusqu'à l'obsession...
vendredi 13 décembre 2013
Gerard-Georges Lemaire
un graphomane éclairé
Rien de plus paradoxal que
l’attitude de Bernard BARILLOT : son art est purement plastique, aux limites de
l’abstraction et, pourtant ses formes se nourrissent d’un autre art, la
calligraphie. Mais il ne pratique pas ce
dernier en tant que tel : il en exploite les ressources et en dévoile les
qualités pour en user dans une autre optique, en toute liberté.
Sa démarche l’entraîne à
construire ses tableaux selon une méthode qui reproduit celle du patient moine
copiste ou du calligraphe arabe virtuose qui transforme les Sourates du Coran
en sublimes vagues de signes. Mais au lieu de servir un texte car il part d’un
texte bien réel il utilise des mots de
l’écrivain pour en soutirer des amplitudes graphiques qui, à la fois,
s’étagent et s’interpénètrent plus ou moins selon les cas. Quelque soit la
solution adoptée, le texte devient presque illisible, bien qu’il reste parfois
en partie compréhensible, comme s’il avait tenu à marquer cette référence (et
cette déférence) par des zones déchiffrables.
Le jeu des couleurs renforce
cette sensation de calligraphie de l’absolu. Il se comporte comme un traducteur
sa traduction consistant à transposer dans la sphère picturale, qui échappe par
définition à l’emprise de l’écrit, un autographe ou une écriture inventée à
partir d’une œuvre littéraire. En sorte qu’il imagine une poésie qui n’aurait
plus pour fondement que des relations intimes de la forme et des harmonies
chromatiques. Ses grandes compositions polychromes, comme ses petites “pages”
peintes sur verre représentent un point précis de la singulière alchimie qui
noue intimement l’écriture et le peinture. Alors que bon nombre d’artistes
avant lui ont tiré parti des signes pour
en faire ces figures fantasques (de Joan Miro à Jean DEGOTTEX, en passant par
Marc Tobey,
Brion GYSIN ou même Antoni
TAPIES), il a Tendance a considérer la ligne comme le substrat de sa création,
comme une partition esthétique, pouvant ou non, subir les variations
fluctuantes d’une mélodie, qui en
détermine la configuration plus ou moins
ordonnée. Ce caractère linéaire est donc une donnée de base dont les lois sont
faites pour être transgressées. En sorte que ces tableaux se proposent comme
autant d’objet de contemplation, mais aussi d’interrogation, de spéculation,
car tous sont des énigmes dont la clef se situe quelque part dans ce sas entre
le conscient et l’inconscient ou se joue la partie d’échecs entre la réalité et
sa représentation : ici plus de représentation, plus de réel, mais une
réécriture qui exaspère les contradictions de la présence de l’artiste au
monde.
Gérard-Georges LEMAIRE.
Pour la revue “Verso arts et Lettres”
jeudi 12 décembre 2013
Inscription à :
Commentaires (Atom)